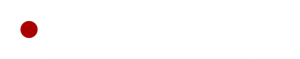Randa Kassis, bien connue de la rédaction d’OMERTA et des médias français, est une anthropologue et femme politique franco-syrienne, notamment fondatrice du Mouvement de la société pluraliste et présidente de la plateforme d’Astana. Depuis les printemps arabes, elle est une figure laïque de l’opposition syrienne, prônant le dialogue, la protection des minorités et s’opposant à l’islamisme radical. Influente, elle a souvent agi comme médiatrice à l’occasion des pourparlers entre Russes, Iraniens, Turcs et Syriens dans le cadre des pourparlers de Genève, Sotchi, Istanbul et Astana. Randa Kassis milite toujours en faveur d’une transition laïque, fédérale et pluraliste en Syrie, malgré la chute du régime d’Assad en 2024, et combat le nouveau pouvoir de Damas d’Abou Mohamed al-Joulani, selon elle composé de jihadistes non repentis. Elle analyse pour nous non seulement l’évolution du nouveau régime syrien depuis les massacres de minorités druzes et alaouites et la chute des FDS pro-kurdes dans le Nord-Est, mais aussi les situations géopolitiques très liées que sont la crise américano-israélo-iranienne et la guerre russo-ukrainienne.
Des pourparlers ont réuni à Genève, les 17-18 février, les délégations américaines et iraniennes. Qu’en est-il ressorti selon vous ? Croyez-vous en un deal a minima sur le nucléaire militaire iranien acceptable par Donald Trump, qui présenterait ainsi son plan comme bien meilleur que le JCPOA de Barack Obama, en réalité assez similaire, voire moins poussé, mais qu’il a dénoncé dès son premier mandat ?
Il est probable que Trump cherche à conclure un accord nucléaire limité qu’il présentera comme supérieur au JCPOA, alors que dans les faits il sera structurellement plus faible. Le JCPOA reposait sur une architecture technique rigoureuse, avec des plafonds d’enrichissement, des restrictions sur les centrifugeuses, et surtout un régime d’inspections intrusif de l’AIEA. Mais même cet accord ne supprimait pas la capacité nucléaire iranienne : il la ralentissait sans la démanteler. L’Iran continuait d’enrichir de l’uranium dans les limites autorisées, tout en conservant l’infrastructure, les compétences et la capacité industrielle nécessaires pour reprendre un enrichissement plus avancé si le contexte changeait. C’est exactement ce qui s’est produit après le retrait américain en 2018.
Aujourd’hui, la situation est encore plus défavorable à un accord solide. Après les frappes de 2025, l’Iran a dispersé, enterré et déplacé une partie de ses infrastructures et de ses stocks. La continuité de la surveillance internationale a été affaiblie, et le programme est devenu plus résilient. Dans ces conditions, tout nouvel accord sera nécessairement plus bancal que le JCPOA, car il sera plus difficile à vérifier et à imposer.
Il faut également comprendre un point central : les Iraniens ne détruiront pas leur uranium enrichi. Au mieux, ils peuvent accepter de le diluer, de le convertir ou de le stocker sous surveillance, mais ils conserveront toujours la capacité technique et matérielle de reprendre rapidement l’enrichissement. Cet uranium, ainsi que l’infrastructure qui le produit, constitue leur principale garantie stratégique. L’abandonner définitivement reviendrait à perdre leur principal levier de dissuasion.
Dans ce contexte, un accord avec Trump aurait avant tout une fonction tactique : réduire temporairement les tensions et permettre un soulagement économique, sans éliminer la capacité nucléaire iranienne. L’Iran pourrait respecter formellement certaines limitations, mais sans renoncer à l’essentiel. Cela rendrait l’accord intrinsèquement fragile et réversible, dépendant davantage du rapport de force politique que d’un démantèlement réel et irréversible du programme nucléaire.
Genève a également accueilli des pourparlers sur l’Ukraine, qui ont réuni des délégations russes, ukrainiennes et américaines. Vous qui suivez autant ce dossier que ceux sur l’Iran et la Syrie – tous plus ou moins directement liés – et étant donné votre expérience des pourparlers complexes sur la Syrie entre Syriens, Iraniens, Turcs, Américains, monarchies du Golfe et Russes, quel est votre sentiment sur l’issue de ces négociations complexes, que les Européens ont d’ailleurs tenté de torpiller ?
Les négociations sont dans une impasse maquillée en diplomatie.
Les Russes restent inflexibles : pour Moscou, le rapport de force militaire doit se traduire politiquement, et il n’est pas question de lâcher grand-chose. Le Donbass est présenté comme un acquis stratégique non négociable, et toute discussion part de cette prémisse.
Les États-Uniens, de leur côté, cherchent avant tout à geler le conflit plutôt qu’à le résoudre. Leur priorité n’est pas la justice territoriale, mais la stabilité régionale et la maîtrise de l’escalade. Dans cette logique, ils exercent une pression lourde sur Volodymyr Zelensky pour qu’il accepte une concession territoriale, notamment sur le Donbass, en échange de garanties de sécurité censées préserver l’Ukraine à long terme. À court ou moyen terme, je ne vois aucune possibilité de conclure un accord. Les Russes continuent d’affaiblir l’Ukraine ; les infrastructures énergétiques sont gravement touchées par des bombardements intensifs, notamment sur Kiev et Kharkov.
L’Iran est-il la prochaine cible de cette stratégie anti–axe Téhéran ? Il semble que votre vision réaliste risque de décevoir ceux qui ont cru en une intervention américaine de regime change contre les mollahs ? …
Non, du moins pas sous la forme d’une guerre ouverte et directe.
Dans cette région, comme ailleurs, les intérêts l’emportent toujours sur l’idéologie, et cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de Donald Trump.
Les pays du Golfe, tout comme la Turquie, refusent une confrontation militaire directe avec l’Iran. Ce refus n’est ni moral ni politique : il est strictement pragmatique. Une guerre régionale contre l’Iran provoquerait inévitablement des représailles, une instabilité généralisée, des perturbations énergétiques majeures et des chocs économiques immédiats. Pour les monarchies du Golfe, comme pour Ankara, le coût serait tout simplement insoutenable. Du côté turc, le risque est double. D’une part, une escalade régionale menacerait directement les intérêts économiques et commerciaux du pays. D’autre part, la Turquie redoute avant tout un nouveau flux massif de réfugiés iraniens. Elle accueille déjà plusieurs millions de réfugiés syriens qui refusent ou ne peuvent pas rentrer en Syrie. Une vague migratoire supplémentaire en provenance d’Iran serait politiquement explosive et pourrait sérieusement déstabiliser le pouvoir de Recep Tayyip Erdoğan, déjà fragilisé sur le plan intérieur par une répression accrue de l’opposition, notamment du CHP. Un tel choc deviendrait rapidement ingérable.
Mais l’élément décisif reste Donald Trump lui-même. Trump n’est ni un stratège militaire ni un président idéologique. C’est un homme d’affaires issu du real estate, et il se comporte sur la scène internationale comme un marchand immobilier. Il négocie par la menace, gonfle artificiellement les rapports de force, dramatise les enjeux, puis cherche l’accord le plus rentable une fois le prix jugé suffisant. Il privilégie le bluff, la pression verbale et la mise en scène, mais évite systématiquement d’aller jusqu’au bout lorsque les coûts deviennent trop élevés, trop longs ou impossibles à contrôler. Dans cette logique, une guerre ouverte contre l’Iran irait directement à l’encontre de ses propres intérêts.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les relations d’affaires de Donald Trump ou de son clan avec les pays du Moyen-Orient ou la Russie qui expliqueraient selon vous sa stratégie ?
Les relations entre la famille Trump et la Turquie, ainsi qu’avec les pays du Golfe, sont anciennes et structurelles, surtout avec la Turquie, bien antérieures à la présidence Trump. Elles ne reposent pas sur un événement ponctuel, mais sur une culture d’affaires durable, principalement ancrée dans le real estate, le licensing et les réseaux de promoteurs proches du pouvoir. Pendant un temps, ces relations sont passées par des intermédiaires comme Tevfik Arif, figure typique d’un capital transnational opaque reliant projets immobiliers, offshore et cercles politiques. Ce canal n’existe plus sous cette forme. Non pas parce que la relation a disparu, mais parce que le mode opératoire a évolué. On est passé d’un intermédiaire unique et exposé à un réseau diffus, composé de cercles d’affaires, de holdings, de promoteurs, de family offices et de canaux informels, beaucoup plus robustes et juridiquement discrets.
Dans ce nouveau schéma, Donald Trump Junior joue un rôle central. Il passe beaucoup de temps en Turquie et dans les pays du Golfe, non pour des raisons diplomatiques, mais pour des raisons d’argent, d’affaires et de consolidation de réseaux. Son statut, sans fonction officielle, sans obligation de transparence politique, lui permet d’agir comme relais économique, garant de continuité et interface familiale, exactement là où un intermédiaire classique serait devenu trop visible.
À cela s’ajoute l’élément saoudien. Le fonds d’investissement de Jared Kushner a reçu un apport direct de deux milliards de dollars du fonds souverain saoudien — un engagement financier massif et exceptionnel. Cet investissement, accordé malgré des réserves internes, illustre le degré de confiance politique et financière accordé au cercle Trump. Il crée, de facto, un enchevêtrement d’intérêts entre la famille Trump et les régimes du Golfe.
Dans ces conditions, une guerre contre l’Iran mettrait en péril : la stabilité des régimes du Golfe, les flux énergétiques et financiers régionaux, les projets immobiliers, touristiques et logistiques, et, indirectement, les intérêts économiques du clan Trump lui-même. Un élément récent le confirme : la famille Trump est directement impliquée dans un accord financier majeur avec les Émirats arabes unis dans le secteur des cryptomonnaies. Une entité liée à la famille régnante d’Abou Dhabi a investi environ 500 millions de dollars dans World Liberty Financial, une société crypto liée à l’écosystème Trump, juste avant son retour à la Maison-Blanche. Cet engagement, purement transactionnel, suppose stabilité régionale et prévisibilité financière. Une guerre contre l’Iran mettrait immédiatement en péril ce type d’investissements, renforçant encore l’intérêt direct de Trump et des régimes du Golfe à éviter un conflit ouvert.
Donc il n’y aura pas de guerre États-Unis-Iran selon vous, malgré l’imposante armada américaine et les pressions israéliennes pour en finir avec le régime des mollahs ?
Trump peut accepter des frappes limitées, symboliques, calibrées pour envoyer un message, rassurer certains alliés ou maintenir une posture de fermeté.
Mais une guerre réelle, longue et régionale reste hautement improbable. Elle provoquerait une riposte iranienne asymétrique, toucherait les intérêts vitaux des partenaires régionaux des États-Unis et déclencherait une spirale incontrôlable, exactement le type de conflit que Trump cherche à éviter.
De son côté, l’Iran l’a parfaitement compris. Téhéran n’abandonnera jamais son programme balistique, pilier central de sa doctrine de dissuasion. En revanche, le régime est prêt à négocier sur le nucléaire, à gagner du temps, à étirer les discussions, notamment jusqu’aux élections de mi-mandat américaines, afin d’observer l’évolution du rapport de forces à Washington. Les discussions indirectes en cours, notamment via des émissaires comme Steve Witkoff, y compris à Téhéran, confirment que la priorité n’est pas l’affrontement, mais la transaction.
Les Israéliens n’ont donc pas réussi à imposer leur agenda de changement de régime ou de frappes massives ? Peuvent-ils s’inquiéter du deal en cours ou essayer de le faire échouer pour entraîner Trump dans une guerre comme en juin 2025 ?
Jusqu’à présent, les États-Unis restent réticents à frapper l’Iran et préfèrent poursuivre les négociations. Cette réticence s’explique en grande partie par les frappes de juin 2025, qui ont démontré les limites d’une option militaire. Malgré les attaques israéliennes, puis l’intervention directe des États-Unis contre des sites comme Fordow, Natanz et Ispahan, le problème central n’a pas été résolu. Les Iraniens avaient déjà déplacé une partie des stocks d’uranium enrichi et réorganisé leurs infrastructures. Le programme n’est ni centralisé ni exposé : il est fragmenté, enfoui et conçu pour survivre à des frappes.
Je ne vois donc pas comment Israël pourrait entraîner les États-Unis dans une guerre. Israël ne dispose pas des bombes pénétrantes lourdes ni des bombardiers stratégiques nécessaires pour détruire efficacement des sites profondément enfouis comme Fordow. Même les frappes américaines de 2025 n’ont pas permis d’éliminer la capacité nucléaire iranienne. Par ailleurs, les missiles balistiques iraniens sont eux aussi enfouis, dispersés et prêts à être lancés depuis de multiples positions, ce qui garantit une capacité de riposte immédiate contre Israël et les bases américaines.
C’est précisément cette réalité qui explique l’hésitation américaine : une frappe peut détruire des structures, mais elle ne peut pas éliminer un programme devenu mobile, enterré et redondant. Elle risquerait en revanche de déclencher une guerre régionale sans garantie de résultat stratégique décisif. Dans ce contexte, Israël peut chercher à influencer ou à perturber le processus, mais il ne peut pas contraindre Washington à entrer dans une guerre dont les conséquences seraient longues, coûteuses et incertaines.
Le régime iranien est-il capable de résister et de rester en place en cas (scénario possible) d’intervention limitée ou massive américano-israélienne ?
Oui. Le régime iranien est capable de résister, même à une intervention militaire des États-Unis ou américano-israélienne. Et c’est précisément pour cela qu’une telle intervention reste, jusqu’à présent, évitée. En cas de frappes limitées, le régime ne tomberait pas. Il les utiliserait au contraire pour resserrer les rangs, renforcer la rhétorique nationaliste et justifier une répression accrue à l’intérieur. L’histoire montre que les régimes idéologiques autoritaires survivent souvent mieux sous pression extérieure que dans des phases d’apaisement. Une intervention massive, en revanche, poserait un autre problème : elle serait extrêmement coûteuse, longue et imprévisible. L’Iran n’est ni l’Irak ni la Libye. Le pays dispose : d’une profondeur stratégique réelle, d’un appareil sécuritaire solide, d’un contrôle social fondé sur la peur mais aussi sur un nationalisme profondément ancré, et de capacités de nuisance régionales majeures. Une attaque directe déclencherait, avec une forte probabilité, une guerre régionale.
Revenons à un dossier qui vous tient à cœur : la Syrie. Quelle analyse faites-vous de la chute du Rojava kurde dans les premiers mois de l’année 2026 en Syrie ?
Il ne s’agit pas d’une chute militaire, mais d’un retrait politique imposé, effectué sans combat, dans le cadre d’un accord négocié entre le pouvoir central syrien du président autoproclamé Abou Mohamed Al-Joulani et le chef kurde Mazloum Abdi, commandant en chef des Forces démocratiques syriennes (FDS) depuis 2015 (coalition arabo-kurde clé dans la lutte contre l’État islamique en Syrie, ndlr). Cet accord a été renforcé et parrainé par Tom Barrack, l’ambassadeur américain en Turquie et homme d’affaires très proche de Donald Trump, notamment chargé du dossier syrien. Allié stratégique des États-Unis, le dirigeant kurde syrien Mazloum Abdi, cité plus haut, prône une décentralisation de la Syrie et tente de naviguer entre pressions turques et négociations avec Damas. Mais le rôle de Barrack est en soi problématique car ce dernier agit moins comme un représentant des intérêts américains que comme un envoyé spécial de la Turquie pour la Syrie… Toute la logique de l’accord épouse d’ailleurs les priorités d’Ankara : neutralisation du projet kurde, dissolution de toute autonomie réelle, et recentralisation du pouvoir sous une autorité islamiste sunnite “acceptable”. Les Kurdes ont donc accepté de se retirer en échange de promesses vagues : quelques postes symboliques, une intégration partielle de certaines unités, et une protection supposée. C’est une erreur stratégique majeure car un jihadiste (comme Joulani et ses hommes) ne fait ni la paix ni la réconciliation. Les accords ne sont jamais qu’une étape tactique destinée à neutraliser sans combattre, à absorber politiquement, puis à éliminer toute force autonome lorsque le rapport de force devient totalement asymétrique. En abandonnant le contrôle du territoire sans résistance, les Kurdes ont perdu leur seul levier réel. Ce qui est présenté aujourd’hui comme une intégration nationale n’est en réalité qu’une mise sous tutelle, prélude à une confrontation différée, lorsque le pouvoir central aura achevé de consolider son contrôle sur l’ensemble de la Syrie.
Mais le deal dont vous parlez n’a pas empêché les massacres de Kurdes ?
Quelques civils et combattants kurdes ont en effet été massacrés dans le Nord-Est, mais le plus grand nombre de Kurdes tués a eu lieu à Alep, quoi qu’en bien moins grand nombre que les Druzes et les Alaouites massacrés par milliers depuis plus d’un an par le régime jihadiste de Damas. À Alep, les choses ont été différentes : la police kurde (Asaech) a été lâchée, et les habitants des quartiers d’Achrafieh et Cheikh Maksoud ont subi des centaines de morts, certes, mais la raison était qu’ils n’étaient pas au courant du deal cynique signé par les forces kurdes du Nord-Est et le régime de Joulani. Ils ont été purement et simplement trahis par les dirigeants kurdes et ils avaient même cru naïvement qu’ils allaient être aidés par les FDS…
Quelle est la suite possible ? Comment vont survivre les Kurdes en Syrie ?
À court terme, les Kurdes survivront, certes, mais à moyen terme, ils seront progressivement étouffés. À long terme, s’ils restent dans cette trajectoire, ils seront carrément éliminés politiquement et sécuritairement. L’accord accepté par Mazloum Abdi n’est pas seulement une erreur stratégique ; c’est une trahison politique. Une trahison vis-à-vis des Kurdes et de leur cause, mais aussi vis-à-vis de toutes les composantes syriennes — Kurdes, Arabes, Druzes, Alaouites, chrétiens, laïcs ; et de tous ceux qui refusent de vivre sous un État dirigé par un groupe terroriste. La Syrie est aujourd’hui dominée par Abu Muhammad al-Joulani. Le changement de nom ou de façade de son organisation jihadiste, jadis Al-Nosra (Al-Qaïda en Syrie), puis renommée Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ne modifie ni son parcours, ni sa méthode, ni sa vision du pouvoir. Dans ce type de configuration, les accords ne sont jamais des solutions durables, mais des phases transitoires. Historiquement et politiquement, lorsqu’un pouvoir islamiste cherche à centraliser et homogénéiser l’État, toute composante autonome finit par être ciblée. Lorsque les voies politiques sont neutralisées, lorsque l’autonomie est dissoute et que le rapport de force disparaît, la confrontation devient une conséquence, non un choix.
La vraie question n’est donc pas de savoir si une forme de résistance émergera, mais quand, sous quelle forme, et à quel prix. Une société privée de représentation réelle, de protection et de garanties finit toujours par produire des dynamiques de confrontation armée, même si ce n’était pas son objectif initial. Ce qui est certain, c’est que la capitulation ne garantit ni la sécurité ni la survie. Elle ne fait que repousser le moment du choc, en le rendant plus violent et plus asymétrique.
Pourquoi les États-Unis, et même Israël, ont-ils lâché les Kurdes ? En échange d’une future normalisation entre Damas et Jérusalem ?
Les Kurdes n’ont pas été “trahis”. Ils ont été sacrifiés… Et oui, cela s’inscrit clairement dans une logique de recomposition régionale, où leur sort pèse moins que la recherche d’une stabilisation globale, même factice. Pour les États-Unis, les Kurdes n’ont jamais été un allié stratégique, mais un outil opérationnel dans la lutte contre Daech. Une fois cette mission achevée, leur maintien est devenu un coût politique et stratégique. D’autant plus que les États-Unis sont aujourd’hui dirigés par un président qui ne raisonne pas en termes d’alliances de long terme, mais uniquement en deals à court terme. Une présence militaire prolongée dans le nord-est syrien signifiait une tension permanente avec la Turquie d’Erdoğan — allié personnel de Trump — et ce type de complexité géopolitique n’entre pas dans la vision simpliste et transactionnelle de Trump. Les Kurdes sont donc devenus un problème à régler, pas un partenaire à protéger. La France, de son côté, s’est contentée d’un rôle marginal et complaisant. Le président français s’est satisfait d’un accord de façade, sans substance réelle, donnant l’illusion d’une solution politique tout en évitant toute prise de risque. Une posture plus symbolique que stratégique. Les Kurdes se sont donc retrouvés sans défenseur réel. Mais il faut aussi le dire clairement : la direction des FDS a mal joué politiquement. Elle a accepté presque intégralement les conditions imposées par les États-Unis, sans conserver de marge de manœuvre, ni levier stratégique, ni alternative crédible. Ils n’ont pas seulement été abandonnés par les puissances ; ils se sont aussi enfermés dans une dépendance totale, qui les a laissés sans protection au moment décisif. Concernant Israël, la réalité est encore plus froide. Le nord-est du pays est éloigné de la frontière syro-israélienne. Il n’existe aucun prétexte de sécurité directe qui justifierait une intervention militaire israélienne dans cette région – surtout si cela devait contrarier Washington. Israël a ses priorités, et la question kurde n’en fait pas partie.
Al-Joulani a-t-il gagné tous ses paris grâce à Trump, à Erdoğan et aux pays du Golfe, notamment le Qatar et l’Arabie saoudite, dans une logique de stabilisation islamiste sunnite contre l’axe pro-iranien ?
Abu Mohammad al-Joulani n’a pas réellement gagné ses paris, du moins pas encore. Jusqu’à présent, ce sont surtout les Turcs, les Qataris et d’autres acteurs régionaux qui ont facilité sa progression et son ascension. Il bénéficie d’un contexte favorable, mais cela ne fait pas de lui un stratège politique. Al-Joulani tente de jouer sur plusieurs tableaux, y compris avec la Russie, mais son instinct politique reste faible. C’est avant tout un homme de terrain, un jihadiste. Il ne comprend pas la politique au sens étatique du terme. Il comprend une seule chose : savoir à quel moment trahir, y compris ses alliés, lorsque le rapport de force évolue. C’est d’ailleurs ainsi qu’il est arrivé là où il est aujourd’hui. Aucun des acteurs impliqués n’est réellement préoccupé par la démocratie, les droits de l’individu, ni par la protection des composantes ethniques ou religieuses de la Syrie. Ce n’est pas le sujet. Leur objectif est une Syrie “stable”, même si cette stabilité passe par un pouvoir islamiste sunnite, tant que celui-ci est perçu comme un rempart contre l’axe pro-iranien. Le problème, c’est que cette lecture est profondément myope. Elle ignore une réalité pourtant évidente : si Abu Mohammad al‑Joulani parvient un jour à consolider réellement son pouvoir, le risque islamiste jihadiste ne restera pas confiné à la Syrie. Il finira par se projeter au-delà de ses frontières, y compris vers l’Europe. L’histoire l’a déjà démontré : recycler un jihadiste au nom de la stabilité n’élimine pas la menace. Cela la diffère, la transforme et finit par l’exporter.
Propos recueillis par Alexandre del Valle