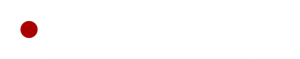Le 31 décembre 2022, lors de ses vœux au peuple français, Emmanuel Macron annonçait qu’il fallait « continuer à aider l’Ukraine sans faillir, jusqu’à la victoire ».
Aujourd’hui, on ne parle plus de poursuivre la guerre jusqu’à la victoire, mais simplement de gagner la paix, en l’occurrence d’obtenir que Vladimir Poutine consente à accepter un cessez-le-feu de trente jours. La nuance est de taille. Objectifs revus à la baisse très nette pour les Européens et ce, pas seulement parce que les Russes continuent de progresser sur le terrain, mais à cause d’un homme, d’un seul : Donald Trump.
Son projet de campagne d’arrêter la guerre avait paru de prime abord comme un vœu pieux, « wishful thinking » comme on dit en américain. Trump a dépassé les cent jours à la Maison Blanche et le projet n’a toujours pas abouti. Mais ça ne fait rien. En se rapprochant des Russes tout en tenant désormais ses distances, Trump a montré explicitement aux dirigeants européens que la guerre sans fin, ça n’était pas son truc, et que s’il décidait de quitter toute forme de soutien à l’Ukraine, les mêmes Européens n’avaient aucunement les moyens de prendre la suite. Tout le monde en a rapidement pris conscience. Le problème, c’est qu’après avoir tout tenté pour faire gagner l’Ukraine, on voudrait désormais imposer la paix à la Russie, avec toujours aussi peu de moyens de pression…
La visite à Kiev ce week-end des quatre leaders que sont Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk et Friedrich Merz avait d’abord pour objectif de manifester en termes d’image un soutien uni de l’Europe à l’Ukraine, dans le but de contrer l’effet planétaire de la démonstration de force de Vladimir Poutine hier à Moscou. « Le défilé militaire de Moscou a marqué une victoire pour Poutine, que l’Occident avait cherché à isoler », écrivait le Washington Post. Une vingtaine de chefs d’État étaient réunis à Moscou, au premier rang desquels Xi Jinping. La présence de Robert Fico, le Slovaque dont le pays fait partie de l’Union européenne, montrait, elle, au grand jour l’absence d’unité sur le continent. À noter aussi que ni Meloni ni Orban ne se sont joints à la bande des quatre, ce qui démontre que l’action de l’Europe sur le dossier ukrainien est compliquée à mettre en place. Ce sont là néanmoins les quatre pays ayant les armées les plus conséquentes du continent qui sont venus à Kiev, et c’est la première fois qu’un tel déplacement est organisé.
Il visait à arracher aux Russes un cessez-le-feu de 30 jours pour mettre un terme à trois ans d’un conflit atroce. Une idée européenne qui remonte au sommet de Londres du 2 mars dernier et que les Américains ont reprise. Il faut noter que les Européens sont dans leur démarche plus solides que les mois précédents, puisqu’ils vont cette fois-ci dans le même sens que les États-Unis. Donald Trump prépare de son côté un nouveau train de sanctions si la Russie persistait à refuser le cessez-le-feu.
En réalité, ce plan a très peu de chances d’aboutir. Moscou ne voudra pas que Kiev profite d’une trêve pour souffler. Dmitri Peskov l’a dit : les Russes craignent que l’Ukraine ne profite de ce répit pour se réarmer et demandent en préambule à toute négociation l’arrêt des livraisons d’armes à l’Ukraine. Et sur le terrain, ils continuent à avancer. Or, ni Kiev ni ses alliés n’accepteront, par exemple, un arrêt des livraisons d’armes durant cette période.
Vladimir Poutine s’est dit néanmoins prêt à réfléchir à la proposition. Il a même proposé de à Kiev de « reprendre les pourparlers directs sans conditions préalables », fixant la date du 15 mai à Istanbul sous l’égide de la Turquie. On se souvient que, début mars, le président russe avait déjà acquiescé à la proposition américano-ukrainienne d’un cessez-le-feu de 30 jours. Il souhaitait y apporter quelques « nuances ». Depuis, on discute toujours de ces nuances…