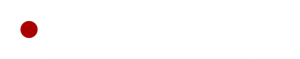OMERTA s’est entretenu avec Randa Kassis, analyste politique franco-syrienne, présidente du Mouvement pour une société pluraliste, figure influente des négociations sur la Syrie, notamment à travers la plateforme d’Astana, qu’elle avait créée. À la fois praticienne et spécialiste des rapports de force entre grandes puissances, notamment russo-américain, elle nous livre ici son analyse des récentes menaces formulées par Donald Trump à l’encontre de la Russie et de ses alliés, dans un contexte où les équilibres géopolitiques restent plus que jamais fragiles.
Les succès supposés de Donald Trump contre l’Iran avec les bombardements sur Fordo en juin dernier puis avec les accords tarifaires humiliants imposés à l’UE, le 27 juillet dernier, l’ont-ils « gonflé à bloc » et fait changer de stratégie sur l’Ukraine ?
Les frappes américaines sur le site nucléaire de Fordow, en Iran, ont été présentées comme un coup décisif. Cependant, selon de nombreux experts, elles n’ont fait que retarder — de 12 à 24 mois au maximum — la progression du programme nucléaire iranien, sans pour autant l’arrêter. Ce sont des frappes tactiques, limitées dans leurs effets, et qui n’ont pas été accompagnées d’un changement stratégique à long terme. En parallèle, Trump a obtenu des concessions commerciales de la part de l’Union européenne et du Japon. Mais il s’agit là encore d’un jeu tarifaire asymétrique : les États-Unis imposent des droits élevés, tout en bénéficiant d’une ouverture des marchés partenaires, sans offrir de contrepartie équivalente. Cela affaiblit les industries européennes dans des conditions de concurrence déloyale – surtout lorsque les entreprises américaines sont soumises à moins de contraintes sociales ou environnementales. Dans un monde où les droits de l’homme sont instrumentalisés de manière sélective, et où les dirigeants européens ont reculé diplomatiquement, la conséquence logique est une réorientation commerciale vers l’Asie. La Chine en profite déjà, de manière discrète mais structurée, à travers des partenariats renforcés avec le Japon, le Vietnam ou l’ASEAN. Ce que nous observons, c’est un exemple typique de gain tactique à court terme (protectionnisme américain), menant à une perte stratégique à long terme (affaiblissement de l’unité économique occidentale et perte d’influence sur l’Europe). Ces “succès” — que Trump brandit fièrement — l’ont sans doute conforté dans sa posture, mais je ne vois aucune stratégie globale sur aucun dossier, y compris l’Ukraine. Je n’observe que des décisions erratiques, non coordonnées, souvent dictées par des calculs d’image ou des intérêts électoraux. Il est donc trompeur de croire que ces actions traduisent une quelconque évolution de stratégie. Il s’agit de réactions ponctuelles, non d’une vision géopolitique articulée.
Comment interpréter son revirement annonçant tout d’abord un ultimatum de 50 jours à Vladimir Poutine et, depuis le 28 juillet, un nouveau de 12 jours, sur fond de menaces militaires et économiques et de critiques croissantes sur les bombardements russes en Ukraine ?
Le revirement de Trump — réduisant son “ultimatum” à seulement 12 jours — n’a rien d’une stratégie sérieuse. C’est une gesticulation, typique de sa méthode : faire du bruit pour masquer le vide. Il parle désormais de “sanctions économiques” comme d’une punition, mais sans plan clair, sans cadre diplomatique, sans vision à long terme. On a l’impression d’assister à une crise d’ego, à un exercice d’affirmation politique brouillon. Il agit comme un adolescent en quête de reconnaissance, multipliant les déclarations pour exister médiatiquement. Les États-Unis, sous sa présidence, prétendent encore incarner une forme d’autorité mondiale, mais ce rôle est devenu une caricature : une police mondiale qui oscille entre ordre autoritaire, corruption d’intérêts et illusion de puissance. Trump n’est ni un faiseur de paix, ni un stratège de guerre. Il ne construit rien, ne structure aucun rapport de force durable, ne propose aucune sortie de crise. Il improvise, menace, recule — sans vision d’ensemble. Ce type de posture, fondée sur des gestes spectaculaires et désordonnés, renforce la confusion internationale sans rien résoudre. Ce revirement sur l’Ukraine n’est pas une inflexion stratégique : c’est un symptôme. Le symptôme d’une politique étrangère erratique, qui sacrifie toute cohérence au profit de l’image et de l’instant.
Donald Trump est-il influencé par la stratégie médiatique de Volodymyr Zelensky et les pressions des Anglais et des néoconservateurs républicains du Sénat américain comme Lindsley Graham qui le mettraient en porte-à-faux ?
Il demeure peu probable que Trump soit réellement influencé par la stratégie médiatique de Zelensky, ou par les pressions exercées par Lindsey Graham. Ce dernier a d’ailleurs perdu une grande partie de son influence sous ce second mandat. Il ne fait pas partie du cercle restreint de Trump, ni sur le plan personnel, ni sur le plan décisionnel. Trump s’écoute d’abord lui-même. Même lorsqu’il donne l’impression d’entendre les arguments de son entourage, il garde la liberté de revenir brutalement sur ses décisions, souvent en fonction de son intuition, de l’effet médiatique ou de son intérêt personnel du moment. L’Ukraine n’est pas un enjeu stratégique majeur à ses yeux — c’est un dossier encombrant, source de contrariétés, et qui ne correspond ni à sa vision du leadership, ni à son style d’intervention. Il n’a jamais réellement apprécié Zelensky, qu’il perçoit davantage comme un acteur médiatique que comme un partenaire diplomatique. Quant à l’idée d’imposer la paix, elle est étrangère à sa méthode : Trump ne négocie pas des compromis durables, il cherche à imposer des postures dominantes, ou à se désengager s’il n’y voit pas d’intérêt direct.
Quels peuvent être les effets des menaces croissantes de Trump, notamment les « sanctions terribles » sur le pétrole russe en surtaxant l’Inde, la Chine et d’autres pays importateurs d’énergies russes ?
Il est peu probable que Trump parvienne à imposer un véritable choc énergétique global en tentant de couper les exportations russes de pétrole par des sanctions dites “terribles”, surtout en visant des pays comme la Chine ou l’Inde. L’Inde est certes plus liée aux États-Unis que la Chine, mais elle ne pourra pas accepter les diktats américains si cela va à l’encontre de ses intérêts vitaux. Les chiffres sont clairs : aujourd’hui, la Russie fournit de 35 à 40 % des importations totales de pétrole brut de l’Inde — soit environ 1,6 à 1,8 million de barils par jour. Cette relation s’est intensifiée depuis 2022, notamment parce que le pétrole russe est vendu à prix réduit, permettant à des raffineries comme celles de Reliance Industries et Nayara Energy de dégager des marges de raffinage extrêmement profitables. Ces marges soutiennent non seulement les exportations indiennes de produits raffinés, mais aussi la stabilité interne de son marché énergétique. Les grandes raffineries privées indiennes, comme celle de Jamnagar (la plus vaste au monde), continuent d’importer du brut russe dans le cadre de contrats à long terme. Même si certaines raffineries publiques ont momentanément suspendu leurs achats fin juillet 2025, sous pression américaine, cela reste une réaction tactique – pas une rupture stratégique. L’Inde a d’ailleurs été très claire : elle ne sacrifiera pas sa souveraineté énergétique ni ne mettra son économie en péril pour satisfaire les intérêts de Washington. Elle l’a déjà dit sans ambiguïté : elle ne deviendra pas une marionnette dans une guerre économique entre grandes puissances. Donc je ne crois pas que Trump puisse aller jusqu’au bout de cette menace, ni en forcer l’application sans déclencher une réaction internationale adverse. Ce serait un pari risqué et contreproductif. L’Inde, comme d’autres consommateurs du pétrole russe, défendra son autonomie. Et ce n’est pas un tweet de Trump ni une salve de sanctions qui changeront cet équilibre.
Comment interpréter que le commandant des forces OTAN en Europe ait menacé ouvertement de détruire Kaliningrad ? Donald Trump a forcément permis ce passage : est-ce sa stratégie de « pression maximale » ou son fameux deal « la paix par la force » ? N’est-ce pas dangereux de fixer des ultimatums si radicaux à Vladimir Poutine ?
Soyons sérieux : menacer de frapper Kaliningrad, c’est provoquer Moscou directement. Cette enclave n’est pas un simple bastion militaire — elle constitue un pivot stratégique, logistique, financier, et symbolique pour la Russie. Une attaque de l’OTAN contre ce territoire serait perçue comme une déclaration de guerre totale. Faut-il le rappeler ? La Russie possède l’arsenal nucléaire le plus vaste au monde. Ce genre de menace n’est pas une démonstration de force, c’est une invitation au chaos. Il est évident qu’une déclaration aussi grave de la part du commandement de l’OTAN en Europe ne peut être lancée sans un feu vert politique implicite. Il est difficile d’imaginer qu’elle ait été faite sans que Trump — au minimum — en ait toléré la diffusion. Ce n’est pas une stratégie de “paix par la force” : c’est une prise de risque aveugle. Trump, fidèle à lui-même, souffle le chaud et le froid. Il laisse croire à Zelensky qu’il peut frapper Moscou ou Saint-Pétersbourg, puis se rétracte devant les caméras dès que le coût médiatique devient trop élevé. Il faut être irresponsable ou totalement déconnecté pour imaginer qu’une guerre ouverte entre l’OTAN et la Russie pourrait être contenue. Ce genre de provocation ne nous rapproche pas d’une sortie de conflit — il nous rapproche d’une bascule incontrôlable.
Propos recueillis par Alexandre Del Valle