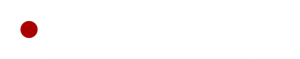La scène a de quoi surprendre. Le ton en premier lieu. Lors de leur conversation, Steve Witkoff et Youri Ouchakov ont l’air de deux vieux copains.
« Mon ami », dit d’abord Ouchakov. Le Russe veut savoir comment s’y prendre pour initier un coup de fil entre son patron et celui de Witkoff. Nous sommes le 14 octobre dernier. Cinq jours plus tôt, Trump a signé le premier grand succès diplomatique de sa présidence : l’accord de paix pour Gaza. Ouchakov, qui parle l’anglais parfaitement, ne nomme pas expressément Poutine. Witkoff appelle Trump « my guy » (mon gars). Et Witkoff explique à son homologue comment s’y prendre pour que Poutine ait avec Trump une conversation productive. Il connaît son patron. Il sait que celui-ci aime la flatterie. Il explique donc qu’il faut le féliciter, rappeler qu’il est un homme de paix, et deux-trois détails encore. On ne peut pas dire que l’Américain livre des secrets d’État au FSB.
Le tollé qui a suivi est sans commune mesure avec la nature de l’échange. Que des diplomates finissent par avoir des liens amicaux alors qu’ils passent parfois plus de temps ensemble qu’avec leur propre famille, n’a rien de choquant en soi. Mais face à un camp européen en mal de prises pour se raccrocher à l’histoire qui s’écrit sous la plume de Trump, c’était une aubaine. Chez nous, évidemment, les habituels zélateurs de la poursuite du conflit, chez LCI entre autres, en profitent pour ressortir leurs vieilles lubies sur Trump, qui serait depuis le départ un agent du FSB. Toute la panoplie des frustrés de l’Ukraine qui depuis bientôt quatre ans ânonnent la défaite de la Russie et se prennent en ce moment le mur du réel en pleine face sont de sortie. À noter au passage qu’en dehors de certains reporters, presqu’aucun des protagonistes de ces chaînes d’infos n’a eu la décence ni fait preuve de la plus petite marque de respect en allant rendre visite en Ukraine aux soldats dont ils exaltent la bravoure à longueur d’antenne. Ils sont bien au chaud sur leur tabouret à parler de la guerre. Je ne leur demande pas d’aller sur le front, simplement dans les régions où ça se passe. Ils en ressortiraient grandis et, pour une fois dans leur vie, ils feraient du journalisme.
Mais revenons aux diplomates. Je me souviens d’une anecdote qui s’est passée à l’époque de la guerre en Syrie. La bataille d’Alep faisait rage. J’étais dans la ville, la partie ouest, gouvernementale, qui était quasi encerclée par les rebelles. Pendant deux jours, on n’a pas pu sortir, tant les bombardements étaient intenses. Je regardais à l’hôtel les pourparlers entre Russes et Américains qui avaient lieu à Genève. Des sessions parfois de neuf heures de discussions. Je lisais les comptes rendus car la télé souvent s’interrompait quand l’électricité venait à manquer, ce qui arrivait plusieurs fois par jour. Un journaliste qui couvrait les négociations racontait qu’un matin, au bout d’une nuit de parlottes, John Kerry, le secrétaire d’État américain à l’époque et Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, étaient apparus devant un parterre de journalistes presque tous endormis. Kerry tenait des pizzas dans les mains, Lavrov des bouteilles de vodka. « Les pizzas sont offertes par les Américains, la vodka par les Russes », avait alors déclaré Lavrov. Les deux hommes avaient dû se concerter, se dire que les pauvres journalistes qui suivaient leurs discussions méritaient un petit cadeau. Ils étaient donc complices, adversaires, mais aussi humains. Et personne ne fut choqué de cette marque de complicité.
Le conseil de Witkoff à Ouchakov ne représente lui non plus aucune trahison d’aucune sorte. Il ne dit à aucun moment que les USA soutiennent Poutine. Trump l’a qualifié de « procédure standard dans une négociation ». Mais voilà, faute de grives, on mange des merles. Et quand on n’a rien à se mettre sous la dent, on extrapole, on fantasme, comme sur tout depuis le début de cette guerre.
Voir aussi : « L’Ukraine ne peut gagner, la Russie ne peut perdre »