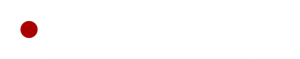En quelques mois, le New York Times, fleuron de la presse américaine, aura gâté ses lecteurs les plus assidus. Le quotidien a en effet levé deux lièvres sur la réalité de la guerre en Ukraine.
Le premier, c’est la présence de douze bases de la CIA le long de la frontière russe, et ce dès le l’Euromaïdan en 2014. L’autre c’est la conception – non seulement au niveau de l’aide militaire, de la formation et du renseignement, mais également de la conduite opérationnelle – d’un pilotage conjoint entre Américains et Ukrainiens d’à peu près tout ce qui s’est passé sur le front en trois ans, et ce, depuis la base américaine de Wiesbaden en Allemagne. Chacune de ces enquêtes contredit la ligne éditoriale pro-Ukraine du quotidien, dont l’audace et le courage sont à saluer, en droite ligne avec l’excellence du journalisme anglo-saxon.

Ça nous fait une belle jambe, me direz-vous, puisque, de la présence de la CIA à la conduite américaine de la guerre, tout le monde en avait plus ou moins entendu parler. Certes, sauf que, jusqu’à ces parutions, impliquer les États-Unis dans la conduite de la guerre en Ukraine ou souligner la moindre présence de la CIA sur le terrain relevait du « complotisme » ou de la « fake news ». Ces révélations montrent l’abîme qui a existé pendant trois ans entre la réalité d’une guerre et sa projection fantasmée sur les opinions occidentales.
Aujourd’hui, les promoteurs de cette narration d’une Ukraine victorieuse et d’une Russie en déliquescence sont à la peine. Ils ont perdu leur boussole. En effet, l’allié américain a décidé de s’asseoir sur la banquette arrière. Enfin, pas tout à fait tout de même, parce que, si on en croit le degré d’implication militaire révélé par le New York Times, Donald Trump aurait juste à retirer ses troupes et stopper net ses fournitures d’armes et de renseignement pour que Poutine gagne en quelques semaines. Donc, même honni, conspué par les âmes bien pensantes, considéré comme « l’homme de Moscou » selon Le Point, Donald Trump reste bien celui qui maintient à flot Volodymyr Zelensky et ses généraux, et non pas Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen ou Keir Starmer, voire les trois réunis avec tous leurs alliés…
Car, malgré ses gesticulations, l’Europe n’est aucunement en mesure de prendre la place des États-Unis sur le front en Ukraine. Si Trump veut la fin du conflit, il a tous les moyens pour l’accélérer en retirant ses billes. Actuellement, les négociations avec Vladimir Poutine piétinent. Cela tient au tempo opérationnel plus marqué des Russes qui, selon le général Oleksander Sysrky, chef d’État-Major de l’armée ukrainienne, auraient commencé leur offensive de printemps.
Dans ce contexte, ces derniers n’ont aucune raison d’arrêter. Ils ont fixé dans la négociation la prise de l’ensemble des quatre oblasts ukrainiens qu’ils ont attaqués : Kherson, Zaporijjia, Donetsk et Lougansk. Or, à l’exception de Lougansk, ils ne contrôlent que deux tiers des autres régions administratives. Pourquoi s’arrêteraient-ils donc ? Ils ont pour le moins les moyens de faire monter les enchères.
Par moments, Trump tape du poing. On sent bien qu’il aimerait que les choses aillent plus vite, mais sa marge est réduite. Sans oublier que s’est ajoutée au contexte chargé la guerre tarifaire qui, même si elle épargne la Russie, provoque des tensions extrêmes avec la Chine, le principal allié des Russes et le pivot des BRICS.
Cet édito est extrait du n°8 d’OMERTA, actuellement en kiosque et disponible dans notre boutique en ligne.