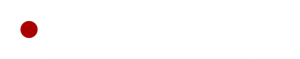Donald Trump s’est envolé. Il est parti cette nuit pour Tel Aviv. En embarquant, il a rappelé à des journalistes que ce qui allait se passer était peut-être la chose la plus importante qu’il soit parvenu à accomplir de toute son existence.
Le fait que le prix Nobel lui soit passé sous le nez est presque oublié devant l’importance du moment. Samedi soir et alors que son négociateur en chef, Steve Witkoff, qui a des allures de diplomate vétéran du Moyen-Orient tant il a bataillé sur ce dossier alors que, rappelons-le, Trump n’a pris ses fonctions que depuis neuf mois, prononçait un discours sur la place des Otages à Tel Aviv. Il était flanqué du genre de Trump, Jared Kushner à sa gauche et de sa femme, Ivanka Trump à sa droite. Lorsqu’il a prononcé le nom du président américain, la centaine de milliers d’Israéliens rassemblés autour des familles des otages s’est mise à scander « Thank you Trump ! Thank you Trump ! » En revanche, lorsque Witkoff voulut rendre hommage à Benjamin Netanyahou, les huées étaient telles qu’il dut s’interrompre trois fois de suite avant de pouvoir terminer son discours.
Les Israéliens savent bien à qui ils doivent le retour des leurs qui doit avoir lieu en ce moment ou dans les heures qui viennent. Beaucoup reprochent à leur Premier ministre d’avoir fait traîner les choses, choisissant chaque fois la voie des armes, de la confrontation, et plaçant la question des otages comme secondaire et leur vie en danger. La dernière offensive sur Gaza City a été très critiquée, y compris dans l’armée où l’ancien chef d’état-major, le général Herzi Halevi l’a vivement critiquée et où même l’actuel, Eyal Zamir n’y était pas favorable. Ils pensaient comme des militaires sur le « bourbier » qu’allait devenir Gaza Ville pour Tsahal. Les familles des otages, elles, voyaient les leurs condamnés, le Hamas ainsi acculé les éliminerait sûrement. Dans la meilleure hypothèse, la plupart mourraient dans les combats…
Cette attitude d’une partie des Israéliens est révélatrice du crédit qu’ils accordent au président américain dans cette affaire. À domicile aussi, même des opposants acharnés à Trump et qui font partie de ses bêtes noires comme Hillary Clinton et Susan Rice ont fait l’éloge du plan Trump. Même les Russes, par la voix de Sergei Lavrov, leur ministre des Affaires étrangères, reconnaissent que le plan Trump est « le meilleur que nous ayons ». Est-ce là un signe qu’un autre « plan Trump » pourrait bientôt fonctionner dans un autre endroit du monde, en l’occurrence l’Ukraine ? Rien n’est moins certain à ce stade, mais l’unanimité qui se fait autour de l’action des Américains au Moyen-Orient méritait d’être soulignée. Il reste qu’une montagne d’obstacles se dresse encore. Les prochaines étapes aborderont des questions épineuses : statut de Gaza, reconstruction du territoire et surtout avenir politique du Hamas. Celui-ci a déjà fait savoir qu’on ne désarmera pas la résistance palestinienne. La route vers la paix promet d’être encore longue. Quoiqu’il en soit, on est face à un événement comme jamais un président américain n’a su en créer dans l’histoire des États-Unis et du Moyen-Orient. Même Bill Clinton avec les accords d’Oslo signés avec Yasser Arafat et Yitzak Rabin en septembre 1993, par ailleurs jamais appliqués, n’avait connu un tel succès.
Alors pourquoi et comment Trump est-il parvenu contre vents et marées à obtenir cette libération et ce cessez-le-feu ? Pour comprendre, il faut en revenir aux premières images de Charm al-Cheikh en Égypte mercredi soir, à la conclusion de l’accord. La station balnéaire du bord de la mer Rouge, dont le surnom de « Cité de la Paix » est particulièrement adapté en ces heures, avait été choisie par les médiateurs égyptiens pour accueillir les négociations, les précédentes sessions ayant eu lieu au Caire, la capitale. Sur les images, on voit les délégations se réjouir de la signature de la première phase de l’accord. Ainsi, le négociateur en chef israélien, Nizan Alon, arbore un grand sourire en serrant la main du Premier ministre qatari, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani. Le chef de la délégation du Hamas, Khalil al-Hayya, est lui plus discret lors de la séance photo. Ni Steve Witkoff, l’homme de Trump de l’Ukraine à Gaza en passant par l’Iran, ni son beau-fils Jared Kushner, pourtant présents dans ces dernières négociations, n’apparaissent. Kushner s’étant vu accusé par la presse américaine de vouloir voler la vedette aux protagonistes s’est sans doute mis de lui-même en retrait.
Cette joie des négociateurs traduit en réalité un immense soulagement. Jusqu’à la dernière minute en effet, le Hamas semblait traîner des pieds. Jusqu’à ce que les autres délégués finissent par leur dire : « Ne laissez pas passer cette chance. C’est le meilleur accord que vous pourrez avoir. » Pour les rassurer, ils ont mis en avant le fait que les garants de son application ne seraient pas les seuls Américains, souvent accusés de jouer un double jeu avec Israël, mais le Qatar, l’Égypte, et même la Turquie. Dans cette affaire, la diplomatie arabe reprend des couleurs. D’ailleurs si le plan connaît ce succès, c’est précisément parce qu’il s’éloigne des projets fous de « Riviera », matinée d’expulsions des Palestiniens de Gaza portés à un moment par Trump, pour embrasser toute la complexité de la région, en tenant compte des équilibres et de la réalité. Les négociateurs qatari, égyptiens et turcs n’ont pas seulement discuté du plan Trump, ils ont mis la main à la patte pour l’élaborer.
La paix à Gaza est-elle pour autant garantie ? Rien n’est moins certain. On a vu, dans le sillage du retrait de Tsahal, le Hamas se redéployer en orchestrant une véritable terreur contre les clans rivaux, accusés d’avoir collaboré avec l’occupant israélien. Pour le Hamas, il y a à la clef, en échange des otages dans le plan Trump, la libération de 1950 prisonniers palestiniens en échange des otages, dont au moins 250 condamnés à vie et 1700 détenus depuis le début du conflit. Le plus célèbre détenu palestinien, Marwan Barghouti, qui est de loin la figure politique la plus populaire dans l’opinion palestinienne, ne sera pas libéré par Israël, ni les corps de Yahya Siwar et de son frère Mohamed rendus au Hamas. Au moment de son départ en janvier dernier, l’ex-Secrétaire d’État américain Anthony Blinken, très impliqué dans les négociations sous l’ère Biden, avait estimé que le Hamas avait déjà reconstitué son potentiel de combattants d’avant le 7 octobre. Nul doute qu’avec les prisonniers relâchés, la force de l’organisation ne va pas diminuer, ce qui rendra immanquablement plus difficile son désarmement prévu dans une phase prochaine du plan, et pour lequel le Hamas n’a toujours pas officiellement donné son accord, que certains de ses membres ont d’ores et déjà refusé. L’absence de Barghouti, surnommé le « Mandela palestinien », montre en outre que les autorités israéliennes ne feront pas tous les efforts pour assurer un avenir à un hypothétique État palestinien, comme le reste du monde le souhaite dans la foulée des reconnaissances du même État.
J’en termine avec une réflexion toute personnelle. Chez nous, l’importance de l’événement et le rôle joué par Trump dans cette paix en voie d’être gagnée sont à mettre en contraste avec le spectacle pathétique qui se déroule au même moment en France, où une classe politique se déchire autour d’une quête impossible d’un gouvernement. Certains, comme Trump, agissent pour le bien de leurs semblables et du monde entier quand d’autres regardent leur nombril, s’accrochent à leurs petites prérogatives et à leur strapontin gouvernemental. La concomitance des deux événements rend le sort de la France encore plus cruel.
Voir aussi : Gaza : la paix au forceps ?