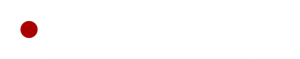Depuis quelques semaines, certains médias espagnols relaient des thèses aussi spectaculaires que suspectes sur le fonctionnement politique du Maroc.
Sous la plume de Sonia Moreno dans El Español ou de Francisco Carrión dans El Independiente, on lit que le royaume serait déchiré par une guerre des services secrets, que des clans s’affronteraient autour de la succession de Mohammed VI, et que des personnages comme Mehdi Hijaouy auraient été les « victimes » de cette lutte souterraine. À lire ces récits, le Maroc serait le théâtre d’un jeu de pouvoir fantasmatique, entre intrigues de palais et rivalités de services. Si le portrait dépeint par la presse espagnole séduira sûrement un public avide de sensations fortes, il ne repose en réalité sur rien d’autre que des mensonges. Il s’apparente en effet à un récit scénarisé, où l’amalgame, l’anachronisme et l’exagération construisent une dramaturgie pensée pour mener une guerre d’influence et de désinformation typique du XXIᵉ siècle.
La guerre des services, un mirage commode
La thèse centrale de ces articles repose sur une opposition frontale entre Abdellatif Hammouchi, patron à la fois de la DGSN et de la DGST, et Yassine Mansouri, directeur de la DGED et ami d’enfance du roi. Les deux hommes seraient engagés, dit-on, dans une lutte acharnée pour séduire le souverain et peser dans la succession royale. Les affaires récentes — Marocgate, Pegasus, jusqu’à l’achat d’une villa parisienne via la société Deschanel — sont mobilisées pour nourrir cette rivalité supposée. Or, les faits contredisent cette lecture. La DGST et la DGED n’ont ni les mêmes missions ni les mêmes périmètres : l’une agit sur le territoire national, l’autre à l’extérieur. Leur complémentarité est connue, notamment dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Loin d’être en guerre, leurs relations sont placées sous le signe de la coordination.
Une information récente vient d’ailleurs démentir frontalement la version espagnole : début août, les deux patrons du renseignement ont passé plusieurs jours ensemble lors d’un séminaire de réflexion stratégique. Ce rendez-vous portait sur les menaces asymétriques et visait à renforcer la liaison interservices dans la lutte contre les trafics transfrontaliers reliant le Sahel à l’Europe. Ce travail conjoint illustre non seulement la coopération opérationnelle, mais aussi la volonté d’aller plus loin dans la mise en commun des moyens de ces services. On est donc bien loin d’une guerre secrète : il s’agit au contraire d’un approfondissement de la synergie entre deux institutions stratégiques.
L’article de El Español évoque par ailleurs une suspension de la coopération sécuritaire avec Bruxelles en plein « Marocgate », en insinuant que Hammouchi aurait cherché à compromettre Mansouri. Mais aucune preuve n’étaye cette affirmation. Le Marocgate fut une affaire de lobbying au Parlement européen dans laquelle les directeurs du renseignement marocain n’ont jamais été mis en cause judiciairement. Là encore, la technique éprouvée consiste à empiler les soupçons et à les personnaliser, pour fabriquer un scénario. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose…
La question de la succession est traitée avec la même légèreté. Le récit oppose deux clans : l’un derrière le prince héritier Moulay El Hassan, l’autre derrière son oncle, Moulay Rachid. Cette hypothèse ignore un fait constitutionnel pourtant limpide : la monarchie marocaine est héréditaire, et le prince héritier est désigné sans équivoque. Jamais la succession récente n’a donné lieu à des luttes de factions comme celles décrites. Agiter ce spectre revient donc à projeter artificiellement une instabilité, qui ne s’appuie sur aucun précédent historique et sur aucun fondement de la Constitution marocaine. La succession monarchique au Maroc n’est pas une zone grise où s’affronteraient des clans rivaux, mais une institution parfaitement codifiée par la Constitution et ancrée dans une tradition séculaire. L’article 20 de la Constitution de 2011 est explicite : « Le trône du Royaume du Maroc se transmet par hérédité aux descendants mâles du Roi, selon l’ordre de primogéniture, à moins que le Roi, de son vivant, ne désigne son successeur parmi ses fils. » En d’autres termes, Moulay El Hassan, fils aîné de Mohammed VI, est l’héritier légitime et indiscutable. Son statut de prince héritier est reconnu officiellement depuis sa naissance et sans contestation possible.
La réhabilitation du faux héros Mehdi Hijaouy avec l’aide de Claude Moniquet
Un autre ressort narratif de ces articles est la mise en avant de Mehdi Hijaouy. Ancien cadre de niveau de la DGED, il est présenté comme un ex-numéro deux persécuté par le régime, menaçant de divulguer des « secrets » et qui aurait été impliqué malgré lui dans diverses affaires et scandales. Le portrait est flatteur, presque héroïque, mais ne correspond pas du tout à la réalité de son parcours. Hijaouy a quitté la DGED en 2010. L’associer au logiciel Pegasus, dont le scandale éclata bien plus tard, est donc un non-sens chronologique. Ses problèmes judiciaires actuels relèvent d’accusations de fraudes bien réelles et d’aide à l’immigration illégale, et non d’une implication dans une prétendue guerre interne des services. Pourtant, à travers une stratégie médiatique bien huilée, avec des avocats connus pour leur sens de la communication, il est mis en avant comme la clé d’un complot plus vaste.
Son entourage joue un rôle non négligeable dans cette mise en scène. Aux côtés de Mehdi Hijaouy, on retrouve ainsi Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE devenu consultant et journaliste. Personnage controversé, souvent qualifié d’ « expert autoproclamé », Claude Moniquet est au cœur de la polémique depuis qu’il a pris la défense de Mehdi Hiajouy dont il fut le sherpa. Selon une source sécuritaire européenne, Claude Moniquet aurait été approché au début de l’année 2025 par les services secrets algériens (CSS/DRS) dans le cadre d’une opération visant à déstabiliser le Maroc. L’objectif affiché serait de perturber la coopération entre Rabat, Paris et Washington, et pour ce faire, Alger aurait choisi de s’appuyer sur Mehdi Hijaouy, ancien officier marocain aujourd’hui impliqué dans diverses affaires d’escroquerie. Écarté de certains cercles occidentaux, Moniquet — qui a longtemps opéré comme sous-traitant officieux de plusieurs services — aurait été réactivé pour discréditer les réseaux marocains. Sa carrière, souvent à la frontière du renseignement, est marquée par une réputation controversée. Dans ce contexte, le cas Hijaouy ne constituerait qu’un prétexte : la véritable cible serait la crédibilité des services marocains auprès de Washington, Paris et Bruxelles. Selon une source proche du dossier, les contenus publiés par Moniquet, notamment dans le tweet cité, s’inscrivent dans un récit orchestré par une cellule média du CSS à Alger.
Ces derniers jours, de nouvelles révélations sont venues éclairer les affaires Claude Moniquet et Mehdi Hijaouy. Selon des sources proches des services de renseignement, l’homme derrière le ciblage de Moniquet serait le général Hassan, de son véritable nom Abdelkader Aït-Ouarabi. Peu après sa nomination à la tête des renseignements intérieurs algériens, en avril dernier, Aït-Ouarabi aurait dépêché l’un de ses adjoints à Bruxelles pour tenter de recruter Claude Moniquet. Cette manœuvre illustre le retour progressif des réseaux du général Toufik, et plus largement du clan Mediene auquel il est proche, au sein des cercles du pouvoir à Alger. L’objectif poursuivi était double : instrumentaliser Moniquet pour nourrir la propagande antimarocaine et renforcer le rôle du Maroc comme levier de mobilisation intérieure en Algérie. Dans ce pays, l’image du Maroc est régulièrement exploitée pour souder l’opinion publique autour d’un « ennemi extérieur ». La stratégie vise également un « coup double » : Moniquet a été l’un des premiers à démontrer formellement les liens entre le Front Polisario et divers mouvements terroristes, ce qui permet de légitimer son rôle dans ce récit.
Depuis lors, le comportement des deux hommes n’a pas cessé d’intriguer. Plutôt que de répondre sur le fond, ils ont tenté une diversion médiatique. À peine deux jours avant l’article d’El Español, ils publiaient ainsi une tribune dans Opinion Internationale consacrée… aux Émirats arabes unis et à Gaza. Un sujet éloigné des accusations qui les visaient, mais utile pour occuper l’espace médiatique et brouiller les pistes. Ce réflexe de diversion confirme l’existence d’une stratégie de communication, où l’essentiel n’est pas de répondre aux faits, mais de déplacer le débat. Dans cette logique, l’article espagnol sert en réalité leur cause : il grossit le profil de Hijaouy, lui offre une place centrale dans une fiction géopolitique, et contribue à le transformer en figure clé d’un Maroc imaginaire. Le procédé est habile, mais il relève davantage de la fabrication d’un récit que de l’établissement de la vérité.
À l’arrivée, ce que racontent Sonia Moreno ou Francisco Carrión ne correspond pas au Maroc tel qu’il est, mais au Maroc tel qu’ils veulent le faire paraître : divisé, instable, miné par les rivalités d’espions et les complots de palais. Dans les faits, la réalité est bien différente : des services qui coopèrent et renforcent leur action conjointe, une succession royale claire, et une stabilité institutionnelle qui fait figure d’exception dans la région. Le « jeu d’espions » décrit en Espagne n’est pas une enquête, c’est une fiction politique. Une fiction qui, derrière son vernis de vraisemblance, poursuit un objectif clair : fragiliser l’image du Maroc et amplifier artificiellement l’importance de figures secondaires comme Hijaouy ou Moniquet.