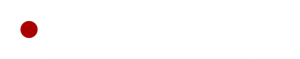Dans un monde marqué par des tensions sectaires et la montée des groupes extrémistes, les Émirats arabes unis se distinguent par une approche unique de la question religieuse — un modèle que l’Europe, incapable d’identifier les semeurs de haine avant qu’ils ne deviennent de véritables terroristes, devrait suivre sans tarder. Loin des modèles répressifs ou laxistes, le pays du Golfe a développé un système hybride combinant un contrôle étatique strict avec la promotion d’un islam modéré et inclusif.
Au cœur de cette stratégie se trouvent des mesures telles que l’uniformisation des prêches dans les mosquées, l’interdiction des Frères musulmans, ainsi qu’une série d’initiatives diplomatiques et législatives visant à éradiquer les racines idéologiques de l’extrémisme. Ce « modèle émirien » n’a pas seulement garanti la stabilité intérieure, il est également devenu une référence mondiale dans la lutte contre le radicalisme et le terrorisme.
L’un des piliers de cette politique est le contrôle centralisé des mosquées sunnites, confié à l’Autorité générale pour les affaires islamiques et les dons (Awqaf). Par la loi, tous les prêches du vendredi – connus sous le nom de khutba – doivent suivre des textes approuvés par le gouvernement, un mécanisme introduit pour empêcher la diffusion de discours incendiaires ou fondamentalistes. En pratique, cela signifie que des milliers d’imams à travers le pays délivrent chaque semaine le même message, centré sur la tolérance, la coexistence et le développement national, en évitant les interprétations radicales des passages les plus belliqueux du Coran.
À Dubaï, par exemple, l’uniformité est totale : comme le confirment des observateurs locaux, chaque mosquée suit le même scénario, garantissant qu’il n’y ait pas d’écarts significatifs par rapport aux thèmes approuvés. Les imams sont soumis à une formation obligatoire et doivent respecter un code vestimentaire standardisé — tuniques et couvre-chefs fournis par l’État —, symbole d’unité et de modération.
« Ce n’est pas seulement du contrôle, c’est de l’éducation », insistent les Émiriens, qui revendiquent fièrement que ce système a drastiquement réduit les épisodes de radicalisation dans les communautés locales et éradiqué le terrorisme. Certains critiques dénoncent une limitation de la liberté de prêcher, mais le gouvernement rétorque que ces mesures ont permis de préserver la paix sociale dans un pays abritant des personnes de toutes nationalités.
Aucune mesure n’a été plus décisive dans la lutte contre le fondamentalisme que la désignation des Frères musulmans comme organisation terroriste en 2014. Ce mouvement, fondé en Égypte en 1928 et connu pour son idéologie politico-religieuse, est considéré par Abou Dabi comme une menace existentielle, accusé d’attiser l’instabilité et la subversion.
Aux Émirats, les « Frères » ont agi pendant des années à travers des associations ayant infiltré écoles, ONG et même cercles gouvernementaux. La réponse émirienne a été multidimensionnelle : arrestations massives, gel d’actifs et procès de centaines de présumés affiliés. Aujourd’hui, l’appartenance aux Frères est punie de peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité, conformément à la loi antiterroriste de 2014 et à la plus récente loi fédérale nᵒ 34 de 2023, qui combat la discrimination, la haine et l’extrémisme. Cette législation étend l’interdiction à toute promotion d’idéologies « extrémistes », y compris la littérature ou les médias exaltant le jihadisme politique.
Les Émirats ne se limitent pas à la répression interne : par une intense campagne diplomatique, ils incitent leurs alliés du Golfe — et surtout les pays occidentaux — à suivre leur exemple. Parfois, ils sont entendus, comme en témoignent les récentes initiatives du Congrès américain visant à classer les Frères musulmans comme groupe terroriste.
« Les Frères musulmans ne sont pas un parti modéré, mais le berceau du terrorisme moderne », déclarait le ministre des Affaires étrangères, Abdullah ben Zayed, en 2017 — un avertissement qui résonne encore aujourd’hui et que seule l’Europe semble ne pas avoir compris.
Mais au-delà du poing de fer, les Émirats misent aussi sur le velours : un vaste programme de “soft power” religieux pour combattre l’extrémisme à sa racine. Le pays promeut un islam tolérant, soutenant chercheurs et initiatives à travers notamment le ministère de la Tolérance et de la Coexistence, créé en 2016, et des événements tels que l’International Dialogue of Civilizations and Tolerance organisé par l’Emirates Scholar Center for Research & Studies, ou encore des lieux emblématiques comme la Maison d’Abraham à Abou Dabi — un complexe interreligieux symbolisant cette vision harmonieuse.
La stratégie inclut également la diplomatie culturelle : les Émirats financent des mosquées et des centres islamiques dans le monde afin de diffuser un « islam pacifique », en contrant les narrations wahhabites ou salafistes. L’interdiction d’importer des textes radicaux complète ce dispositif, le gouvernement proscrivant explicitement tout matériel extrémiste incitant à la violence.
À l’heure où les menaces djihadistes se multiplient, les Émirats offrent l’exemple d’un islam embrassant la modernité tout en gardant le contrôle sur le radicalisme religieux.
Certes, le modèle émirien a ses détracteurs : certaines organisations de défense des droits de l’homme accusent le pays d’utiliser la lutte contre l’extrémisme pour faire taire la dissidence politique. Pourtant, les résultats sont incontestables : depuis 2014, aucun attentat significatif n’a frappé le territoire, et le pays figure parmi les premiers au monde en matière de tolérance religieuse.
Le projet le plus symbolique reste la Maison d’Abraham à Abou Dabi, inaugurée en 2023, qui réunit sous un même toit une mosquée (Imam Al-Tayeb Mosque), une église (St. Francis Church) et une synagogue (Moses Ben Maimon Synagogue). Ce complexe unique au monde incarne le dialogue interreligieux et attire l’attention mondiale comme symbole de coexistence.
Le pays compte également une quarantaine d’églises chrétiennes, desservant une communauté représentant environ 12,6 % de la population, et a encouragé l’expansion des lieux de culte juifs, notamment après les accords d’Abraham de 2020. À Dubaï, la communauté juive dispose de synagogues, d’écoles religieuses et de bains rituels (mikveh), tandis que le gouvernement garantit la liberté de culte par des décrets explicites. En outre, des temples hindous et treize autres lieux de culte non musulmans ont été ouverts pour accueillir les diverses communautés religieuses du pays.
Aux Émirats, la religion est un instrument de paix, non de division. Cet exemple devrait inspirer l’Occident : il suffirait de copier et d’adapter le modèle émirien à nos sociétés pour que les résultats soient visibles en très peu de temps.
Alessandro Bertoldi
Publié dans ilRiformista.it